Jean-Marie Bigard a un jour tonné « C’est au pied du mur qu’on voit le mieux le mur ». J’utiliserai cette expression pour désigner ce qui suivit les premiers événements sus-narrés.
En effet, sans le savoir, mon compère et moi-même avions touché un mur. Le mur froid et placide de la justice. Nous étions de petits jeunes capitalistes de Berlin Ouest face aux bureaucrates implacables de Berlin Est. Et nous n’arrivions pas en conquérant. Enfin, si. Au début…
C’est presque hilares et désinvoltes que nous nous rendons au chef des nains à matraque. S’étant persuadés mutuellement que nous n’avions finalement rien fait de grave, nous nous étions détendus en parcourant les 50 mètres qui nous menaient à notre juge en tenue de lumière. Il comprendrait surement notre incartade vers les cieux artistiques de Marcel Duchamp et nous relâcherait bien vite pour aller défendre la veuve et l’orphelin que nous ne représentions, de toute façon, pas. Celui-ci fut en fait intraitable : nous étions non seulement cons, mais bel et bien coupables. Il le criait haut et fort (nous devions être ses premières proies, il fallait surement marquer le coup pour asseoir son respect), si bien que mon sourire se dissipa. Celui de B restait étincelant, comme s’il croyait encore pouvoir influer sur l’atmosphère de la soirée. Mais ne parlons plus d’atmosphère dorénavant, nous parlerons d’histoire avec un grand H.
Nous, vulgaires acteurs de seconde zone dans l’histoire de la nation, avions été choisis pour servir d’exemple.
Ou, nous avions été tout simplement terriblement stupides.
Alors que les invectives du sous-commissaire pleuvaient encore, B me proposa à l’oreille de dorénavant s’exprimer en « ancien français », mais l’agent le remarqua et devint rouge comme s’il avait ses règles : « Je vous embarque ! ». Celui-ci joignit le geste à la parole en s’emparant de notre précieuse pièce à conviction (qu’il avait préalablement liée astucieusement par le tronc) et en tentant de l’enfourner nerveusement dans le coffre de sa voiture banalisée. La situation était drôle, nous rîmes. « Ha, ça vous fait rire ?! Et bien vous allez le prendre sur les genoux. »
Et nous voici, saluant d’un air malicieux les témoins de la scène qui nous voyaient partir, tout enjoués, à l’arrière d’une BMW avec un mannequin sur les genoux essayant de s’enfuir par la fenêtre comme s’il était le seul passager convaincu de sa culpabilité. Durant le trajet, je spécifiais à B que l’on ferait mieux de « la jouer cool et attendre que ça se tasse » (je parle moins bien que j’écris, c’est un fait). Celui-ci acquiesça et, peu de temps après, nous arrivâmes dans l’immense tour grenobloise qui abritait, et abrite encore, le siège de la maréchaussée nationale. D’emblée, et sans jamais avoir vu la couleur d’un commissariat, nous comprîmes l’ampleur des opérations dans la ville et notre manque de chance : personne n’était là pour nous recevoir à part un petit sergent simplet qui suivait les ordres comme on suit une jeune féline au teint pâle à l’arrêt Bastille (sur la ligne 1). Celui-ci eut du mal à épeler le nom de famille de B ce qui est souvent un mauvais présage dans ce genre de cas, B étant arménien, donc potentiellement étranger. Après avoir vérifié notre identité ainsi que notre possible passif, celui-ci nous gratifia d’une sentence qui aura ensuite tendance à revenir (trop) souvent après cela : « Vous êtes vraiment les deux jeunes gens les plus cons que j’ai jamais rencontrés ». Cela est à prendre avec désarroi de la part d’un agent de police, même si je comprends aujourd’hui que cette sentence pouvait aussi faire office de compliment, nous situant, mon compère et moi dans des sphères auxquelles nous n’appartenions visiblement pas, vu notre accoutrement et l’ampleur ubuesque que prenait notre incartade mannequine. Ce à quoi il ajouta : « En tout cas, on ne va pas pouvoir prendre votre déposition maintenant. Nos équipes sont surchargées, je vais vous mettre en garde à vue ». N’ayant presque jamais entendu ce mot et ayant encore une vision candide de l’humanité, j’acceptais avec le sourire comme s’il eut pu s’agir d’une crèche pour enfant avec des boules de couleur. La vergogne maintenant me fauche quand j’avoue avoir cru qu’une GAV pouvait durer une heure ou moins.
Et nous voici, B et moi, attendant patiemment devant une porte mystérieuse en compagnie d’un agent pataud. Passifs et souriants, toujours convaincus de la drôlerie de la situation qui n’allait surement pas tarder à se débloquer. Je me risquais, pour briser le silence étouffant, à questionner l’agent : « Excusez-moi, mon bon monsieur, combien de temps dure une garde à vue par chez vous ? ». Celui-ci me répondit avec le ton bonhomme d’un fermier du Loir et Cher : « Ha ben, une GAV c’est jusqu’à demain matin au moins ! ». B et moi faisons d’un seul coup volte-face, apeurés : « Pardon ?! Jusqu’à demain ?! Mais nous avons des obligations monsieur ! –Ouais moi j’ai cour de physique ! –Et moi d’espagnol ! Et nous n’avons même pas de pyjama ! ». Un sourire vicelard se forma sur le visage fatigué de notre geôlier qui trouvait enfin l’occasion de faire la morale à une personne autre que sa femme et son chien: « Ha ben, fallait y réfléchir avant de faire la connerie ! ». Ayant déjà plusieurs fois tenté d’expliquer notre geste, nous restâmes silencieux au risque d’énerver le léthargique en uniforme, mais notre expression se fit plus grave, comprenant que nous avions peut-être agit avec précipitation et que la soirée risquait d’être plus mouvementée et moins drôle que prévue. B se mit à trembler. L’homme nous fit passer dans une antichambre froide en face d’une nouvelle porte de laquelle sortaient en pagaille des cris inhumains : « Non ! Lâchez-moi ! C’est mon bébé ! » (En y repensant, nous avons peut-être rajouté ces mots au fur et à mesure de nos narrations pour donner une tonalité plus dramatique à la situation).
B ne pouvait plus refréner ses tremblements, imaginant sans doute les pires atrocités réservées aux gens de son rang et à leur anus propret dans ce cercle qu’il n’avait jamais réellement côtoyé. Et moi non plus d’ailleurs… Même si je peux me targuer, après cet épisode malheureux, d’avoir poussé la curiosité sociale un peu plus loin que celle de mon collègue, dorénavant gesticulateur grossier dans une foire à l’art. D’ailleurs, pour ma part, je m’enfermais dans un mutisme patient ainsi que dans mes bras qui, eux, n’ont jamais tremblé. Même en période d’alcoolisme étudiant (ndlr).
La porte s’ouvrit enfin, offrant à nos yeux un spectacle infernal, bien loin de ceux auxquels nos mirettes d’hédonistes étaient habituées : en face de nous un comptoir et une vingtaine de postes de télévision retransmettant la folie des cellules. Des cris, des hurlements, un gardien colossal posté derrière la banque nous regardait avec des yeux hagards de brute épaisse en poussant des grognements, son visage se reflétait à l’infini sur un sol totalement inondé. Les tremblements de B devinrent des spasmes.
L’agent m’emmena en premier, traversant la petite salle. Mes pas clapotaient jusqu’à une porte que nous franchîmes rapidement. Celui-ci m’ordonna alors, dans un jeu presque pervers, de me déshabiller entièrement dans l’eau. B avait fébrilement demandé, juste avant cela, si la fouille anale était une légende, ce à quoi notre geôlier avait répondu évasivement par quelques soupirs de mauvais augure. Par chance, celui-ci me demanda juste de tousser puis de me rhabiller. Ce que je fis, n’ayant jamais eu réellement de problème à me montrer nu devant une tierce personne (c’est un don). En remettant mes habits sur mon corps froid, je lui demandais s’il était possible, dans sa grande mansuétude, de me mettre en cellule avec mon jeune ami qui, lorsque je l’avais quitté, commençait vainement à sangloter. L’agent me répondit encore évasivement, mais presque positivement cette fois-ci en me disant qu’il allait essayer. Cela ne sera jamais fait, bien sûr. Je léguais mes effets personnels au gardien ainsi que mes lacets de Converse et n’eut pas le temps de me tourner vers B qu’on m’emmenait déjà vers une porte de cellule opaque dans un couloir qui s’apparentait à celui de l’asile “Jack Nicholson”. Au moment de l’ouvrir, je me rendis compte que les cris les plus impressionnants venaient de cette même cage et, inspirant avec difficulté, je me convinquis intérieurement de survivre « peu importe ce qu’il y a à l’intérieur ».
L’ouverture dramatique à l’aide d’un trousseau de légende mit plusieurs minutes. Des heures pour votre serviteur. La porte s’ouvrit enfin sur une pièce de quelques mètres carrés aseptisée, non décorée. Pas de toilette, un banc, une caméra. Mes yeux sondèrent très rapidement ce placard en commençant par la périphérie. Plus mes pupilles s’habituaient à la crasse et sombre lumière, plus je me rendais compte que les murs étaient recouverts de sang et que l’unique homme qui trônait là, au milieu de la pièce, était lui aussi tartiné d’hémoglobine. Celui-ci tirait une tronche que je n’ai jamais oubliée depuis. Il s’était levé précipitamment en entendant le bruit de la serrure et accueillait le gardien avec des invectives mêlées de doléances. Il n’avait pas un regard pour moi, partiellement pétrifié, comme si j’avais croisé la gorgone. Le gardien fit semblant de ne pas entendre et referma bien vite la porte derrière moi, me laissant seul avec cet homme d’une trentaine d’année, dont les yeux exprimaient une ivresse destructrice assez rare. Je m’assis sur le banc et ne dis rien. Celui-ci, après quelques insultes à l’endroit des geôliers ainsi que du corps judiciaire dans son ensemble, fit la même chose et ne me parlera qu’après dix bonnes minutes de silence.
Heureusement pour moi, il s’instaura bien vite la fameuse fraternité entre codétenus.
Après m’être installé de la manière la plus virile possible sur la paillasse lisse et grise, mon colloc se calma, comprenant qu’il n’était pas du bon côté des plaintes, et commença à me zieuter. Celui-ci finit par me demander ce que je faisais là. Ce à quoi je répondis timide et vergogneux, à la manière d’un écolier à qui on présente une bite en lieu et place d’une sucrerie. Offrant mon anecdote honteuse à la sentence populaire, je laissais nonchalamment l’individu me rire au nez et me traiter, encore une fois dans la soirée, d’abruti. Je lui demandais à mon tour ce qu’il avait osé faire pour se retrouver ici avec une telle gueule. Il me répondit d’un ton laconique qu’il avait « fait la fête » et, emporté par son élan, n’avait pas vu qu’il faisait « des freins à main sur les rails du tramway ». Je ne dis rien, mais n’en pensais pas moins. Celui-ci, très premier degré, continua : « Ces enculés m’ont chopé et m’ont mis en cellule avec une paillasse, un chiotte, mais pas de matelas. Alors j’ai demandé un matelas plusieurs fois, sans réponse » (son discours est ici, simplement retranscrit à la lueur de mes souvenirs, il était beaucoup plus imagé et fleuri en réalité). Face à ce silence, mon acolyte de circonstance avait répondu par la menace : « Je vais inonder ! », trois fois. Et face au manque de réaction, celui-ci était passé à l’acte en empoignant une couverture poisseuse qu’il avait enfoncé de toutes ses forces dans les toilettes à la turque qui trônaient là. Plusieurs chasses d’eau plus tard, il avait réussi le tour de force d’inonder la totalité des cellules (je me trouvais donc en présence de l’un des premiers responsables du chaos qui régnait ici-bas, et cela me rendait toutes choses) enfantant une réaction, mais pas celle qu’il avait espérée : le gardien aux allures de bouledogue trisomique l’avait passé à tabac hors caméra. Les insultes racistes faisant parti du folklore, rendant la chose plus épique et rude. Celui-ci s’était ensuite retrouvé dans une cellule sans latrine pour ne pas réitérer ses exploits.
Après cette longue narration imagée qui me tint en haleine faute de mieux, mon coloc’ eut néanmoins le toupet de chercher à m’inquiéter en me balançant un : « …Mais toi par contre, c’est grave ce que t’as fait. C’est du recel, si le procu le décide tu peux passer 24 heures de plus ici ». L’idée ne m’enchantait guère même si j’étais persuadé, en début de « soirée », que je ne pouvais pas longtemps faire long feu dans cette cellule poisseuse dont les habitants d’un soir n’appartenaient pas vraiment à ma classe sociale et dont certains, comble de l’horreur, ne connaissaient peut-être pas Pierre Desproges. Ce « procu » (je croyais que c’était son prénom) allait bien comprendre le caractère inoffensif de notre couple artistique (il le fallait à tout prix) ou je me suiciderais tel Tany Zampa dans les geôles meurtrières de la patrie hypocrite.
Pourtant le temps filait et aucune trace de salut à l’horizon. Pas de bouffe non plus, les condés étaient surchargés. Le couloir ne dormait cependant jamais, gerbant une lumière aveuglante à chaque entrée ou sortie d’invités prestigieux sur le tapis rouge du crime. Pour ma part, je m’ennuyais. Mon coloc, après un débat houleux sur la pensée stoïciste et le problème éthique lié à la nanotechnologie, avait préféré rendre les armes pour quelques instants et roupiller en prenant une grande partie de la paillasse. Moi je tournais en rond, me récitant des vers ou des citations célèbres, essayant de chanter pour ne pas céder à l’angoisse. Une angoisse nouvelle que je rajoutais à ma longue liste de peurs ancestrales (avec notamment celle des météorites, de la fin du monde et de faire caca la porte ouverte) : le constat de sa propre faiblesse physique.
Alors que l’ennui ainsi que la fatigue m’avaient poussées à partager un brin de place avec mon fêtard automobile, je fus réveillé, aux alentours de 4 heures du matin, par le bruit d’une clef dans la serrure imposante de notre porte. Croyant y voir le signe d’une rédemption tardive accompagnée de plates excuses de la part du corps policier dans son ensemble et du ministre de l’intérieur, je me levai bien vite. Suintant l’allégresse ainsi que l’urine contenue. L’agent, aussi flegmatique qu’une limace sous crack, me désigna bel et bien, entraînant de nouvelles invectives de mon colocataire qui s’était levé et rhabillé pour rien.
Le léthargique, aussi enjoué que la porte qu’il venait de déverrouiller, m’emmena dans une salle sans mot dire et me présenta à un gendarme dont l’inexpressivité arrivait à faire passer mon premier geôlier pour le rigolo de la bande. Celui-ci m’ordonna d’ôter une nouvelle fois mes habits, ce qui, à 4 heures du matin, n’est pas la meilleure manière de commencer la journée. Je ne peux pas lui en vouloir après coup. Celui-ci devait surement penser avant tout à sa propre sécurité au cas où l’on m’aurait glissé du C4 au fond du rectum et à l’insu du lourd sommeil légendaire des cellules poisseuses.
Je m’exécutais, impatient de voir la suite et dans une forme éblouissante. Celui-ci, après avoir constaté mon absence de charisme et d’arme rectale, me fit me rhabiller puis m’emmena, après m’avoir soigneusement menotté, à l’extérieur. Dans le froid crispant nous attendaient un fourgon noir comme de ceux que l’on croise sur l’A7 transportant des équidés, ainsi qu’un autre gendarme tout aussi joyeux que le premier, qui tenait fermement B que je n’avais pas vu depuis plusieurs heures. Celui-ci, posté à quelques mètres de moi, était totalement paniqué. Les cheveux en bataille, sa belle chemise débraillée et froissée et, surtout, ses yeux de myope cherchant, dans le noir et sans lunettes, à distinguer des formes humaines sur lesquelles vociférer fortement. A l’évocation de son prénom, celui-ci se tourna en ma direction et me prit à parti avec ferveur : « Regarde moi, j’ai des menottes Brandon, des menottes ! ». Emphasé comme à son habitude, je remarquais néanmoins, dans ce monologue contenu (par peur de représailles surement) une crainte jamais aperçue auparavant lors de nos nombreuses péripéties Rhône-alpines. Celle-ci me fit l’effet d’un petit choc, comme si une fille s’apercevait que son copain grande gueule n’est finalement pas capable de la défendre lors d’une rixe urbaine.
Sur le coup, je n’étais que paniqué d’avantage. Je demandai alors à l’agent qui me tenait aussi fermement que s’il avait tenu Jacques Mesrine, où il comptait nous amener. « A la gendarmerie, pas loin, on désengorge les cellules ». Cette explication n’eut pas fait de me convenir ni de me rassurer. D’autant qu’après nous avoir placé l’un et l’autre dans deux petites cages dans lesquelles nous ne pouvions que poser notre séant, faute de place, tout en regardant défiler les paysages, nous nous sommes bien vite aperçus que le voyage, fort long pour nous, passait par quelques routes sinueuses, éclairant au passage des arbres touffus. Le même sentiment de faiblesse insidieuse nous prit en même temps avec B. Il précéda une paranoïa de circonstance, notre cargaison continuant sa course dans la nuit noire et l’enfer du doute. J’étais déjà persuadé que la police n’avait pas prévenu mon entourage de ma situation et je n’avais pas cru nécessaire d’appeler un médecin au premier contact, si bien qu’à voir les grands arbres qui nous faisaient face par-delà notre meurtrière chevaline, nous ne pouvions nous empêcher de penser que le camion allait s’arrêter au détour d’un chemin campagnard, nos geôliers revêtant soudainement l’habit de bourreau, nous exécutant sans sommation dans un fourré à l’abri des regards. Peut-être avions nous mis le doigt dans un engrenage qui nous dépassait et que nous en paierions le prix à notre insu. « Pas de témoin » disait le léthargique dans mon cauchemar avant de me loger une balle de Famas dans la nuque. Il ne fallait pas déconner avec la mafia des T shirts.
Par veine, le camion ne trouva pas d’endroit isolé et s’arrêta au bout d’une bonne demi-heure de route devant un bâtiment froid et banal qui s’apparentait au siège de la gendarmerie même si nous ne pûmes jamais réellement le vérifier : tout était éteint, sans vie et aucune pancarte n’indiquait clairement la dénomination de notre lieu de souffrance.
Car le pire restait à venir. Les deux larrons en uniforme nous conduisirent B et moi dans deux cachots personnalisés. Ceux-ci comprenant un matelas pouilleux, des toilettes à la turque et une vitre totalement opaque, laissant comprendre que le soleil n’avait pas autorité à venir réchauffer nos âmes de damnés en ces lieux. La solitude assombrie est bien pire pour une âme fragile comme la mienne. Aux multiples crises d’angoisse qui suivirent durant nos six heures d’enfermement se succédaient les hurlements de B qui me conseillait, par cellule interposées, de dormir énormément et de ne pas céder à la panique en tapant sur ma porte blindée. J’allais apprendre plus tard que cette attention particulière à l’égard de mes névroses cachait une peur plus grande pour B : celle de devoir partager subitement sa cellule avec un sodomite patenté. Je compris, encore plus tard, que mon mentor de toujours avait une aversion caractérisée à l’égard de ce qui pouvait représenter, de près ou de loin, une forme de pédérastie. Plus que la douleur et l’absence de naturel, celui-ci devait surement se demander à quoi ressemblait la conversation post coïtale, emprunte de moment de gêne et d’égarement. B détestait encore plus les silences que moi.
Moi, je pensais juste à ma propre mort et à l’anonymat inconcevable que pouvait constituer le trépas en cellule. Je n’avais pas d’ambition politique, mon enfermement ne pouvait donc pas revêtir une cause noble. J’étais juste seul comme un con.
6 heures passèrent sans un mot ni un bruit poussé par le monde extérieur. Après l’onanisme d’ennui et la métaphysique de circonstance venaient les besoins primaires. Il a fallu attendre 10 heures du matin pour que commencent à frémir les murs de la gendarmerie et que la vie militaire reprenne au son du clairon, accompagnée de son bruit métallique de Famas à la ceinture et de sa cadence inimitable. Grattant la porte avec politesse je finis par demander un verre d’eau que l’on me sommât de rendre dans les cinq minutes après qu’une hôtesse peu aimable m’ait entrouvert la porte. Vers 10h30, les gonds grincèrent à nouveau et nous nous retrouvèrent dehors, accueillis par des flics gradés et débonnaires qui semblaient prendre le relais des gendarmes. Je dois avouer que, depuis lors, je n’ai jamais été aussi content et apaisé de me retrouver dans le sillage procédurier d’un agent de police, les militaires m’ayant rapidement prouvé qu’au royaume des aveugles, le borgne est roi.
Les deux cyclopes nous emmenèrent donc, exténués mais un peu plus décontractés, dans une voiture banalisée, nous débarrassèrent de nos menottes et nous taquinèrent en nous affublant du surnom créatif de « gang des mannequins », nous répétant à l’envie que l’on restait les jeunes gens les plus cons qu’ils n’avaient jamais croisé. B ne pipait mot, se montrant moins prolixe et enjoué qu’en début de soirée. Arrivés à notre poste bien aimé, les deux lieutenants gratte-papiers nous prîmes séparément et simultanément dans le but de relater notre version des faits et de rédiger une déposition. J’avais hérité du tôlier, B avait eu la jeune recrue impulsive, celle qui ne respecte pas les règles et se fait sa propre justice, en tout cas c’était la mythologie que nous leur créions instantanément. Eux n’étaient pas férus de mythologie et préféraient relater des faits clairs et précis. Nous passions donc en revue l’intégralité de notre soirée à commencer par notre sombre délit. A la question délicate de savoir pourquoi nous avions dérobé le mannequin je répondis que nous avions, mon ami et moi, des visées artistiques assez floues mais que le mannequin s’apparentait, selon toute vraisemblance, au centre névralgique de notre travail créatif. B, quant à lui, ne s’embarrassa pas de détails, mais plutôt de références en répondant tranquillement : « Ben, c’était pour faire comme dans Orange Mécanique ».
Au cliquetis lents et bruyants des touches du clavier de mon lieutenant s’ajouta son manque d’ambition littéraire, ce que je lui fis remarquer par une remarque un peu trop désobligeante : « Excusez-moi, vous ne faites que marquer la même chose « nous avons décidé avec B etc… », il serait plus judicieux d’utiliser le passé simple pour aérer le texte, essayez avec « nous décidâmes ». Le lieutenant perdit son sourire et me rétorqua sèchement que « ce n’était pas une dissertation » enrayant, par la même, toute possibilité de connivence ultérieure entre lui et moi et donc de passe-droit sous la forme de donuts ou de burgers. Plus son texte se finissait, plus je me détendais. La vérité se rétablissait, signe que le cauchemar de mon camarade et moi-même touchait à sa fin. Pourtant, l’agent, une fois son mauvais brouillon imprimé, me regarda et répondit à mon air inquiet par ces mots : « Bien, maintenant nous allons vous remettre en garde à vue ». A ma crispation soudaine et à mon soupir pétri d’inquiétude, il ajouta : « Vous êtes plus d’une dizaine à avoir été saisis dans cette affaire de vol depuis hier, or c’est au procureur d’analyser chaque déposition pour vérifier que votre ami et vous-même n’êtes pas réellement rentrés dans la boutique, auquel cas, de recel de vol nous passerions à vol organisé, ce qui serait plus grave. Vous devez donc attendre patiemment la décision et nous vous libérerons vers 18h, si tout va bien. ».
« Encore une journée de foutue » disait Jacques Higelin. Mon corps ne répondait plus et mes nerfs étaient sur le point de péter dans un bruit fracassant. Je prenais néanmoins sur moi, m’appuyant sur les promesses évasives d’un sous-lieutenant bébête. On me remit dans la même cellule qui avait vue naître mes ambitions carcérales et mon flegme mafieux. Mon colloc était toujours là, plus calme car plus fatigué, mais tout enjoué de retrouver de vieux amis. En effet, la cellule de 7 mètres carrés (600 euros par mois sur le PAP parisien) accueillait aussi deux nouveaux venus, tous deux maghrébins. L’un semblait avoir un peu plus de mon âge, d’un calme impérial et d’une courtoisie à toute épreuve, il avait emmené un sandwich et pestait gentiment contre les geôliers pour ne pas l’avoir autorisé à emmener plus de nourriture en cellule « on aurait pu se faire une bonne bouffe » répétait-il d’un ton charmant. J’appris, au détour d’une conversation introductive, que celui-ci n’était là que pour une heure, une sorte de rattrapage d’une soirée qui avait aussi mal tourné que la nôtre, à n’en point douter. Mais le pire semblait déjà derrière lui, au contraire du troisième larron, un algérien d’une quarantaine d’année, le sourire constamment aux lèvres, rappelant Khaled. Celui-ci tenait constamment son bras droit dans un bandeau fait à la va vite. Le gentilhomme ne parlait pas bien français mais réagissait à nos questions par des onomatopées très expressives. Lorsque je demandais pourquoi cette belle personne se retrouvait blessée en notre compagnie, le jeune homme répondit à sa place laissant l’intéressé réagir d’un rire discret. « Ho, lui il est mal en point »-petit rire discret-« Il va pas revenir de sitôt, pas vrai ? »-rire plus bruyant de l’intéressé et de l’interrogateur- « Hein ? Ta carte de séjour va péter mais on est bien ici ? C’est pas comme au Maroc où on est quinze en cellule ! Et là, en plus, on a eu à manger, pas vrai ? (L’autre ne pouvait s’empêcher de rire et de corroborer avec son bras en écharpe) C’est le 5 étoiles ! ». Le jeune homme me chuchota ensuite que notre blessé jovial avait accidentellement renversé un CRS avec sa voiture et qu’on comptait désormais en heure son éviction du territoire, Sarkozyste à l’époque. En compagnie de ces joyeux drilles antisystème je me sentais un peu plus à mon aise. Nous devisions joyeusement en attendant nos différentes sentences, même si, derrière notre ton jovial, un fin sociologue aurait pu déceler une inquiétude croissante, notamment chez votre serviteur dont l’idée même d’un possible reconduit de 24 heures en cellule faisait frissonner chaque partie de son jeune corps.
En effet, si les forces de l’ordre s’étaient trompées jusque-là et n’avait pas su saisir l’essence comique et percutante de notre geste, il n’y avait aucune raison qu’elle ne nous fasse pas porter le chapeau dans cette affaire Bygmalion Bis.
Néanmoins, je n’avais pas le temps de réfléchir outre mesure. Le poste et ses cellules vivaient, en journée, d’une cadence infernale, faisant sortir puis entrer nombre de détenus, calmant les ardeurs des uns, réfrénant les envies des autres, restant tantôt sourd, tantôt à l’écoute selon le tour de garde du vigile aux mille et une télés. On me conduit même dans une salle blanche habitée par plusieurs personnes masquées dans le but d’inscrire, pour toujours, mes données génétique dans le grand répertoire de la répression. La séance se déroula en détente, les agents étant plus aptes à communiquer et moi-même satisfait que mes blagues puissent enfin avoir du répondant chez ces membres de la police scientifique. Ça ne volait pas bien haut, mais c’était déjà ça. Je renâclais néanmoins à l’idée d’offrir mes empreintes de doigt à de parfaits inconnus. Ceux-ci me rassurèrent à l’aide d’un contre-argument fatal : « Nous avons déjà toutes les informations dont nous avons besoin si vous avez un portable et Facebook dessus ». La photo fut belle, ne pouvant pas m’empêcher de sourire, les rats de labo m’exprimèrent leur contentement « C’est mieux quand c’est vous qui faites le mannequin ». Et à l’un d’eux de rajouter que « décidément, vous avez été très cons ». Le passé composé employé pour la première fois, me rassura un tantinet.
Puis vint la dernière heure, celle de l’attente. La plus longue jamais vue, celle qui fait resurgir les doutes, la faim (nous n’avions rien mangé depuis 21 heures) et surtout l’ennui. A six heures pile la porte s’ouvrit, faisant rugir des gonds incertains, et l’agent nimbé d’une lumière blanche appela… mon co-détenu, et lui annonça qu’à l’avis du procureur tout puissant, celui-ci devait rester 24 heures de plus dans la geôle pour « atteinte à la vie d’autrui ». Ce à quoi il répondit très posément : « puisque c’est comme ça, je veux un matelas ». Mort de trouille, mon tremblement ne stoppa qu’à 18h31, quand enfin on vint me chercher, tout flasque, me trimbalant dans le couloir tant usité durant ces deux derniers jours. J’aperçus B, lui aussi hagard, déboussolé. On nous remit nos affaires, je récupérais mes converses et les lacets qui vont avec. Je ne disais rien, impatient à l’idée de retrouver une liberté de façade, celle des murs gris et pollué de la capitale Alpine. De revoir ce tramway high-tech, ce centre piéton sur lequel nous avions joué mainte fois de la guitare, ce mac do qui nous appelait d’un souffle discret mais sûr…
Au moment de franchir la grande porte du commissariat, je me tournais vers B marqué d’une fatigue qui rendait ses traits horrifiques et disgracieux. Celui-ci prononça sa première phrase d’homme libre : « Putain, ces connards m’ont volé mes clopes… J’y retourne ». Le saisissant par le col, je l’empêchais alors de créer un esclandre qui aurait pu nous être fatal et je lui ordonnai de m’accompagner manger.
J’appelais ma famille qui répondit immédiatement. Mon père, très calme, me fit son habituelle liste de recommandations : « Maintenant tu vas aller manger, puis t’enfermer et dormir, ok ? » plus soulagé qu’en colère. Je n’aspirais qu’à cela de toute manière.
Illustration: J.Bardaman
Tags: Brandon Banal



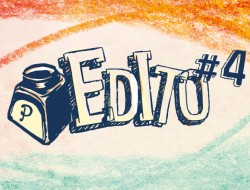






Joli coup.
Long mais lisible, introspectif mais généreux, isérois mais funky, un reportage nécessaire.
Bon courage pour votre prochaine première fois.